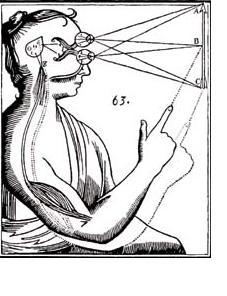Manuscrit soumis à la révue Raisons Partiques. Ne pas citer sans autorisation. Tous droits réservés.
Draft. Paper submitted to the review Raisons Pratiques. Do not quote. All rights reserved.
Mais qu’y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent, et que leurs discours indéfiniment prolifèrent ?
Michel Foucault, L’ordre du discours.
Speech is the highest and lowest human function, the endroit charnière between the mechanical grunt of the vocal chords and the poetry of cognition
Alice Kaplan, French Lessons
Epistémologie du témoignage : la dépendance épistémique de la parole des autres
Quelqu’un vous adresse la parole, vous dit quelque chose, et vous le croyez. Cette forme banale d’interaction est au centre d’un débat en épistémologie sociale portant sur le rôle du témoignage dans l’acquisition des connaissances. Comment pouvons nous acquérir des croyances justifiées par le biais des paroles d’autrui ? Le discours n’est-il que le véhicule de connaissances justifiées par d’autres moyens ou peut-il lui-même en assurer la justification?
La dépendance épistémique d’autrui est un phénomène majeur dans la vie humaine. Peu de connaissances peuvent être acquises sans l’aide d’autrui voire sans la médiation d’institutions sociales et de technologies inventées et maîtrisées par d’autres. Sans cette « division du travail cognitif » typique des sociétés humaines, notre vie cognitive ne serait pas très différente que celle des autres animaux.
La dépendance épistémique de la parole d’autrui comporte des difficultés épistémologiques supplémentaires : le langage est trompeur, les possibilités de manipulation et de mensonge sont infinies. Dans quelles conditions sommes-nous justifiés à croire ce que nous disent les autres? Comment éviter le risque de crédulité que toute acte de confiance dans nos interlocuteurs comporte ?
Les questions que soulèvent la fiabilité du témoignage et le statut de la communication comme véhicule de connaissance se retrouvent tout au long de l’histoire de la philosophie. L’épistémologie traditionnelle – de Platon aux néo-empiristes – fait peu de cas de cette forme d’accès au savoir : l’idée même d’une connaissance acquise par le truchement d’autrui semble incompatible avec l’autonomie intellectuelle qui caractérise le sujet connaissant rationnel. On pourrait même voir l’histoire de l’épistémologie comme celle d’une série des prescriptions et des règles de conduite de l’esprit visant à le protéger des risques de crédulité et d’ « infection » par le faux. Juste à titre d’exemple, parmi les « principes de régulation de l’opinion » que Locke discute dans son Essai sur l’entendement humain, une des obligations visant à renforcer l’autonomie de l’esprit est de ne pas accepter d’idées sur la base de l’autorité .
Le débat épistémologique autour de la confiance à accorder au témoignage d’autrui a été relancé dans l’épistémologie contemporaine par un nombre de travaux qui re-évaluent le témoignage comme source de connaissance et le placent au même niveau que d’autres ressources considérées traditionnellement comme plus fiables, telles que la perception ou l’inférence. Contre la vision philosophique classique du témoignage comme source de fausses croyances et de distorsions, une épistémologie du témoignage s’est constituée pendant les dernières dix années à l’intérieur de l’épistémologie sociale. Elle s’articule autour d’une opposition entre deux positions principales, le réductionnisme et l’anti-réductionnisme. Selon le réductionnisme, qu’on fait typiquement remonter à David Hume , la croyance en un témoignage est toujours justifiée par des raisons indépendantes de celui-ci, raisons qui sont elles mêmes fondées sur des sources de connaissance plus fondamentales telles que la perception, l’inférence et la mémoire. Selon Hume, notre confiance en un témoignage est établie a posteriori, après avoir observé une corrélation stable entre ce que le témoin rapporte et la réalité, c'est-à-dire, après avoir nous-mêmes établi la fiabilité du témoin, par une inférence inductive ordinaire. Selon l’anti-réductionnisme, traditionnellement associé au philosophe écossais Thomas Reid , le témoignage n’est pas réductible à d’autres sources de connaissance . La version contemporaine de l’anti-réductionnisme défendue notamment par Anthony Coady et Tyler Burge , plaide pour une justification a priori du savoir acquis par la communication : pour ces auteurs, le langage n’est pas seulement un véhicule d’informations : il est une source de légitimation de nos croyances .
Dans cet article je voudrais analyser plus de près la plausibilité d’une approche anti-réductionniste du témoignage, en explorant d’une part les bases cognitives du développement de la confiance en la parole d’autrui et d’autre part les mécanismes pragmatiques à l’oeuvre dans l’interprétation des témoignages. Il me semble en effet que les arguments anti-réductionnistes fondés sur les propriétés de la communication linguistique ne prennent pas suffisamment en compte la complexité des processus cognitifs et des interactions sociales impliqués dans l’apprentissage et dans la communication.
Deux arguments contre le réductionnisme
L’anti-réductionnisme contemporain procède d’une ré-évaluation du langage comme source de légitimation épistémique. Je prendrai ici en considération deux des objections qu’il oppose au réductionnisme. Une première objection part du constat que, dans la plupart des circonstances, il est impossible d’établir d’une façon indépendante la fiabilité d’un témoignage sans s’appuyer sur d’autres croyances elles-mêmes tirées de témoignages. Si je peux tenter de vérifier d’une façon indépendante un témoignage selon lequel l’aspirine fait baisser la température, je reconnais un cachet comme étant un cachet d’aspirine en vertu d’autres connaissances acquises par témoignage. Ceci est d’autant plus évident que l’on prend en compte la dimension de l’apprentissage : ma capacité d’afficher aujourd’hui des raisons positives pour mes croyances dépend d’un long processus d’apprentissage au long duquel j’ai dû accepter sur la simple base du témoignage ce que signifiaient les mots et quelles étaient les règles du discours. Au moins pendant l’enfance, l’apprentissage ne saurait s’appuyer sur la quête de raisons indépendantes permettant de s’assurer de ce qu’on a appris. L’acquisition des outils linguistiques et conceptuels qui rendront possible nos inductions sur la fiabilité des témoignages est elle-même intrinsèquement dépendante du témoignage d’autrui. Dans les mots de Thomas Reid : « la nature veut que nous soyons portés dans les bras d’une mère, avant que nous puissions faire usage de nos jambes ; elle a voulu pareillement que notre croyance fût dirigée par l’autorité et la raison des autres, avant qu’elle pût l’être par nos propres lumières. La première de ces deux intentions nous est suffisamment révélée par la faiblesse de l’enfant et la tendresse de la mère ; la crédulité de la jeunesse et l’autorité de l’âge attestent avec évidence la seconde »
La seconde objection au réductionnisme que je voudrais considérer ici mène, elle aussi, à voir dans le discours même non seulement un véhicule, mais une source de légitimation des connaissances et se fonde sur le fait que le locuteur prend la responsabilité de ses actes de parole. Le fait que quelqu’un parle ne fournit pas simplement une donnée d’observation du même ordre que celle fournie par d’autres comportements ou d’autres phénomènes. La communication a un rôle épistémique qui lui est propre. Un acte du langage fournit un type de donnée très spécial : il établi une relation de croyance non pas – ou non pas seulement – entre un sujet et un état de chose dans le monde mais entre deux sujets. Croire ce qui m’est dit c’est avant tout croire la personne qui m’adresse la parole. Il y a donc une forte asymétrie entre la situation épistémique ordinaire où les croyances d’un sujet s’appuient sur un ensemble de données – situation que le réductionnisme considère comme paradigmatique même dans le cas du témoignage – et ce qui se passe lorsque nous croyons un interlocuteur. Il s’agit alors d’une relation entre deux sujets intentionnels, l’auteur d’un acte de parole et le destinataire de cet acte. Cet aspect si manifeste du « croire autrui » a été négligé par les auteurs qui pourtant attribuent un rôle épistémique spécifique à la communication, exception faite par Richard Moran , qui a défendu cette ligne d’objection et selon qui la spécificité du « dire » tient à la responsabilité mutuelle des interlocuteurs.
Dans ce qui suit, je voudrais prendre au sérieux ces deux objections – que j’appellerai l’objection développementale et l’objection pragmatique – en les considérant non seulement comme des objections de principe, mais en essayant aussi d’en saisir la portée empirique à travers une compréhension des mécanismes cognitifs en jeu dans l’apprentissage et dans la communication. Une examen de l’ontogenèse et de la pragmatique de la confiance épistémique devrait également aider à dépasser la polarisation entre réductionnisme et anti-réductionnisme dans l’analyse du témoignage.
Les bases cognitives de la dépendance épistémique : l’ontogenèse de la confiance
C’est un lieu commun de penser que, s’il existe une prédisposition à la crédulité, c’est dans l’enfance qu’elle se manifeste le plus clairement. Les enfants, dépourvus d’autonomie intellectuelle, se retrouvent dans une situation de déférence fondamentale vis-à-vis de leur parents ou instructeurs. Leur confiance dans la parole des autres est un ingrédient du processus d’apprentissage : sans une bonne dose de confiance préalable, il ne serait pas possible d’apprendre quoi que ce soit. Certes, les enfants sont naïfs et les capacités d’évaluation épistémique se développent d’une façon graduelle. Ce n’est pas pour autant que les enfants sont de simples « enregistreurs » de toute information provenant des adultes. La psychologie cognitive des vingt dernières années a montré que, contrairement à ce que pourrait suggérer leur extrême vulnérabilité et leur dépendance des autres pour leur survie, les enfants ont, dès la naissance, une vie cognitive bien plus riche et plus autonome que cette « prometteuse bruyante confusion » à laquelle William James réduisait l’expérience perceptive d’un nouveau né . Les enfants n’arrivent pas au monde avec un cerveau pareil à une tabula rasa sur lequel l’apprentissage culturel inscrira les concepts et les règles du raisonnement. De nombreuses recherches montrent l’existence chez les enfants pré-linguistiques de capacités cognitives hautement articulées leur permettant de traiter d’une façon différenciée les stimuli qu’ils reçoivent de l’environnement. Un bébé de 5 mois, par exemple, se représente un objet solide comme une entité indépendante avec des propriétés physiques telles qu’il ne peut pas être dans deux endroits au même temps, ne peut pas traverser un autre objet solide, etc . D’autres expériences montrent qu’à cet age les bébés ont une discrimination numérique des objets, et des attentes sur leurs mouvements. Contra Piaget, selon qui les connaissances abstraites se construisent progressivement par l’observation et l’internalisation des régularités externes à travers l’interaction sensori-motrice avec l’environnement, cette nouvelle approche du développement cognitif met en évidence des capacités représentationnelles précoces chez l’enfant qui guident sa structuration des informations qu’elle reçoit de ses sens.
De même, l’enfant n’est pas dépourvu de toute ressource cognitive propre face à l’information qui lui provient d’autrui. A partir d’environ l’age de 9 mois et de façon rapidement croissante, donc avant le développement du langage, le bébé montre des capacités d’attention conjointe et de compréhension des buts de certaines actions d’autrui qui lui permettent d’avoir des attentes sur le monde social autour de lui, d’en tirer parti et de le manipuler à son avantage . On peut soutenir que les capacités de mentalisation, qui se développent d’une façon indépendante du langage, sont à la base de la compétence communicative de l’enfant et jouent un rôle crucial dans l’apprentissage linguistique même . L’enfant est donc un acteur social bien plus sophistiqué que ce qu’on pourrait croire. Mon hypothèse ici c’est que les compétences psychologiques et communicatives de l’enfant lui permettent de s’en remettre à autrui, en particulier dans la formation de ses croyances, de façon moins totalement passive et vulnérable qu’on ne le suppose généralement . Cette hypothèse converge avec la deuxième objection présentée aux arguments réductionnistes, selon laquelle le rôle épistémique de la communication est très différent de celui d’autres sources d’acquisition de savoir basées sur l’observation et l’induction. Croire ce que dit autrui est un processus cognitif basé sur d’autres inférences: c’est l’intentionnalité de l’acte communicatif du locuteur qui détermine notre confiance dans ce qu’il nous dit et en assure une légitimation au moins partielle.
Un être capable d’une lecture élaborée du monde social a donc un avantage non seulement relationnel, mais aussi épistémique grâce à une compréhension plus fine des intentions et des compétences de ses sources d’information. Plusieurs auteurs plaident aujourd’hui pour une explication de l’ « exception culturelle » caractéristique de l’espèce humaine basée sur le développement d’une théorie de l’esprit, ou d’un sens des autres, qui nous donnerait un avantage non seulement en termes de socialisation mais aussi d’accumulation culturelle et d’apprentissage . Du point de vue développemental, nombre d’expériences récentes montrent une corrélation entre développement d’une théorie de l’esprit et capacité d’évaluation des sources d’information. Les enfants autour de 4 ans développent une théorie de l’esprit plus sophistiquée qui leur permet d’attribuer des croyances fausses aux autres . En même temps, ils deviennent plus sceptiques dans l’acquisition d’information (par exemple, dans l’apprentissage de nouveaux mots), en dosant leur confiance selon les performances de leurs informateurs . L’ontogenèse de la confiance épistémique est donc à reconstruire à l’intérieur du rôle de la mentalisation dans l’apprentissage. Un enfant n’apprend pas un nouveau mot par une simple association : il s’appui sur l’acte intentionnel de son informateur pour fixer la référence du mot (cf. Bloom 2000). Ainsi, ce lien étroit entre reconnaissance d’intention et apprentissage par le truchement d’autrui pourrait constituer une base empirique pour une légitimation épistémique d’une « confiance primitive » dans la parole d’autrui. En prêtant attention aux intentions d’autrui, l’enfant, qui a un accès très limité à l’acquisition autonome de connaissance, se retrouve avec un mécanisme d’acquisition d’information qui est beaucoup plus puissant sans être pour autant passif.
La confiance préalable que l’enfant fait à la parole d’autrui est associée à sa capacité de reconnaissance d’un acte de parole comme acte intentionnel. Au cours du développement, le raffinement de ses compétences sociales lui permet d’évaluer la crédibilité des ses interlocuteurs ainsi que d’en éprouver la sincérité. Le développement des compétences épistémiques et celui des compétences psychologiques restent étroitement lié : apprendre à mieux évaluer les sources d’information passe par une compréhension plus fine des stratégies intentionnelles des autres. Bref, pour connaître le monde il est crucial de connaître les autres : notre « sens social » joue un rôle fondamental dans le développement de notre compétence épistémique .
La recherche psychologique sur le développement de la confiance épistémique nous livre le schéma suivant :
Développement de la confiance épistémique:
16 mois: Les enfants distinguent entre affirmations vraies et fausses et apprennent les mots d’informateurs qui montrent les capacités intentionnelles adéquates (Baldwin & Moses 2001)
2 ans: Les enfants construisent l’identité des agents en partie sur leur fiabilité passée et commencent à montrer de la méfiance sélective envers les autres (Pea 1982)
3 ans: Les enfants retiennent l’information qui provient d’informateurs fiables et sont sensibles au degré d’assurance de l’informateur (Clément et al, 2004)
4 ans: La méfiance sélective des enfant s’élargi aux informateurs négligents et ils sont moins réceptifs aux informations trompeuses en provenance de locuteurs naïfs. Il commencent néanmoins à sur-estimer la fiabilité des informateurs fiables (Sabbagh, Baldwin, 2001 ; Welch-Ross, 1999)(d’après M. Koening et P. Harris (2005) « The role of social cognition in early trust », TICS, 9, 10, p. 457).
Ce développement conjoint des capacités de mentalisation et des capacités épistémiques permet de remettre en question, au moins au niveau du développement, l’opposition radicale entre réductionnisme et anti-réductionnisme. Ceux qui défendent une position anti-réductionniste en utilisant l’objection développementale, soutiennent que l’apprentissage est un cas de déférence fondamentale à autrui, c'est-à-dire, un cas de crédulité pure où on se fie aux autres sans aucune raison. Selon Coady , par exemple, il ne peut qu’en aller ainsi car c’est impossible d’acquérir un langage sans acquérir en même temps des croyances vraies sur ce dont on nous parle. En d’autres termes, il est impossible d’imaginer une situation d’apprentissage du langage qui ne présuppose pas la vérité des témoignages sur le monde qui nous permettent cet apprentissage. Lorsqu’une mère dit à son fils de 2 ans « le four est brûlant » elle lui apprend en même temps et d’une façon indissociable des mots et un fait du monde. Elle peut se tromper, mais si l’erreur ou la tromperie avait été dominant dans les situations d’apprentissage on a du mal à comprendre comment l’apprentissage linguistique et donc la langue elle-même auraient pu se stabiliser comme pratiques culturelles. Or, l’hypothèse que je soutiens ici c’est que l’association entre communication linguistique et acquisition des croyances n’est pas si automatique : la mentalisation sert de médiation entre apprentissage linguistique et acceptation du témoignage. C’est à travers la reconnaissance d’un acte intentionnel que l’enfant infère ce qu’on lui est dit .
La compréhension et l’apprentissage sont des processus bien plus riches et inférentiels que ce que l’on suppose habituellement. La présence de processus inférentiels tout au long de l’apprentissage et de l’acquisition du langage pourrait donner un argument aux réductionnistes, car elle semble montrer que la confiance dans le témoignage n’est pas primitive mais se fonde sur d’autres types d’inférence. Certes, une vision inférentielle de la communication affaiblie l’idée d’un principe de crédulité reidéen : croire les autres n’est pas un tropisme, mais un processus mental qui suppose une activité cognitive autonome . Néanmoins, les processus d’inférence en jeu dans la mentalisation ne sont pas un cas d’inférence inductive générale : la compréhension d’autrui se base sur une « théorie de l’esprit » tacite, qui nous permet de faire des inférences très particulières à partir d’inputs spécifiques (tout comme une théorie physique naïve guide nos inférences sur la trajectoire des objets inanimés). Un examen plus attentif des processus cognitifs impliqués dans l’acquisition des croyances par le biais d’autrui atténue ainsi le contraste entre réductionnisme et anti-réductionnisme, en nous permettant de reformuler la question. Il ne s’agit pas tant de savoir si il a ou il n’y a pas de processus inférentiels, mais plutôt de comprendre quelle est la nature des processus inférentiels impliqués et comment interagissent les inférences sur les autres et les inférences sur le monde.
Cette interaction entre compétence communicative et compétence épistémique nous amène à considérer de plus près la deuxième objection, l’objection pragmatique et à tenter de mieux éclairer les mécanismes pragmatiques à la base de la confiance épistémique.
Présomption de vérité, coopération et posture de confiance : esquisse d’une pragmatique de la confiance
Dans le célèbre roman de Jerzy Kosinski, Being There , rendu encore plus célèbre par le film interprété par Peter Sellers, Mr. Chance est un vieux jardinier mentalement retardé qui n’est jamais sorti de son jardin. Son patron meurt, il sort pour la première fois dans la ville de Washington, est renversé par une voiture et grâce à une série de coïncidences fortuites, il se retrouve à habiter dans l’appartement d’un tycoon de la finance américaine et à dialoguer avec les hommes et le femmes les plus en vue des Etats-Unis. Un jour, le Président des Etats-Unis en visite lui demande son avis sur la mauvaise saison à Wall Street. Mr. Chance répond, comme toujours, avec des phrases vagues sur la vie du jardin : «Dans un jardin la croissance a sa saison. Il y a le printemps et l’été mais il y a aussi l’automne et l’hiver. Et ensuite à nouveau le printemps et l’été. Tant que les racines ne sont pas coupées, tout est bien et ira bien ». Après une sérieuse réflexion, le président interprète ces propos comme un constat profond sur la symétrie fondamentale entre nature et société et les cite à la télévision le lendemain même. Bien sûr, nous ne sont pas ici dans un cas d’échange conversationnel ordinaire : il s’agit d’un cas extrême de « sur-interprétation » dont les effets de malentendu amusent le lecteur. Mais est-ce que les cas d’interprétation quotidienne de la parole d’autrui sont radicalement différents de celui-ci ? Considérons la façon dont Président interprète Mr. Chance. Il lui attribue une certaine crédibilité en tant qu’interlocuteur à cause du contexte social de leur rencontre : Mr.Chance est apparemment un ami de son ami, donc, par un effet de réputation et de réseau social, il est un interlocuteur digne d’attention. Le Président s’attend à que Mr Chance contribue d’une façon appropriée à la conversation, donc sur-interprète ses propos conformément cette attente. Il interprète ce que dit Mr. Chance dans le contexte de ses propres croyances sur l’état de l’économie américaine : d’où le sentiment que la phrase de Mr. Chance est particulièrement perspicace et profonde. Les idées du Président sur l’économie américaine que cet échange avec Mr. Chance inspire, vont évidemment bien au-delà du maigre et vague commentaire de ce dernier sur les saisons du jardin.
Cet exemple caricatural peut néanmoins nous aider à mieux comprendre les rapports entre communication et acquisition de croyances. La communication verbale est un processus inférentiel riche et articulé et non pas un simple transfert d’information d’une tête à une autre. A chaque fois que nous nous engageons dans un échange conversationnel, nous participons activement à la construction d’un ensemble des pensées, d’hypothèses générées « pour le bien de la conversation » et que nous allons retravailler et retenir en partie à la lumière de nos propres croyances. L’investissement dans ce travail cognitif d’interprétation et de compréhension mutuelle requiert une confiance dans le fait que notre interlocuteur est en train de jouer le même jeu et d’accepter un ensemble de règles tacites qui guident notre conversation, et en particulier qu’il s’efforce de dire des vérités pertinentes. Dans le cas de Mr. Chance, le malentendu dépend du fait que cette présomption est erronée : Renfermé dans une forme d’autisme, Mr. Chance répète des phrases sans les connecter au contexte de la conversation. L’effet de malentendu devient ainsi matière à fiction. Dans le roman, personne ne se rend compte du malentendu en dépit d’interactions répétées, avec des conséquences spectaculaires : Mr. Chance devient un gourou de la politique et de la finance américaine et un candidat possible à la présidence des Etats-Unis. Dans la vie réelle, la confiance, et en particulier la présomption de vérité peuvent toujours être remises en cause en fonction de la façon dont les échanges évoluent et s’enchaînent. Voyons de plus près comment se met en place et se maintient cette présomption de vérité dans la conversation, et quelle est son rôle dans la justification du témoignage.
L’idée que la communication requiert une présomption de vérité est désormais une platitude philosophique : au cours du XXème siècle cette idée a pris la forme de différents principes et règles de communication : à la suite de W.V.O Quine , Donald Davidson a invoqué un principe de charité interprétative selon lequel tout acte d’interprétation nécessiterait une attribution massive de croyances vraies à nos interlocuteurs. David Lewis a proposé une convention de vérité dans L partagée par les locuteur d’une langue L et qui fonde l’interprétation sémantique des expressions de L. Paul Grice a proposé une série de maximes de régulation de la conversation, parmi lesquelles une maxime de qualité qui nous enjoint à dire le vrai. Certains arguments anti-réductionnistes sur le témoignage reprennent ces principes pour justifier au moins en partie a priori les croyances acquises par le biais du témoignage. L’argument, dans sa forme générale est le suivant : puisque l’usage même du langage requiert un lien entre parole et vérité, nous pouvons, en absence d’indices contraires, faire confiance aux dires des autres. Pourtant, cet argument se heurte à plusieurs objections. L’invocation de principes à la Davidson ou de conventions à la Lewis donne peut être des conditions « transcendantales » de possibilité d’acquérir des croyances justifiées a priori par le biais du témoignage, mais elle n’explique pas un trait phénoménologique très saillant de cette acquisition, à savoir la confiance que nous faisons à la personne qui nous parle du fait même qu’elle nous a intentionellement adressé la parole.
Grice, lui, prend en compte la dimension intentionnelle de la communication, en voyant dans l’acte de dire quelque chose à quelqu’un la réalisation d’une intention très particulière puisqu’elle a besoin, pour aboutir, d’être reconnue comme telle par le destinataire de cet acte. C’est la reconnaissance d’une elle intention qui suscite chez le destinataire la présomption que le locuteur s’est conformé aux maximes de la conversation et en particulier à la maxime de qualité. Il y a pourtant même dans le cas de Grice deux objections possibles : premièrement la maxime de qualité est trop rigide. Lorsque le locuteur viole cette maxime Grice est obligé de conclure que le locuteur ne dit rien, mais « fait comme si » il disait quelque chose, et ce afin de véhiculer un message implicite. Cette analyse ne fonctionne pas du tout dans les cas très ordinaires d’expression vague ou approximative où les critères épistémiques contextuellement à l’oeuvre n’exigent non que le locuteur disent vrai mais seulement qu’il ne trompe pas le destinataire. En second lieu, les maximes semblent jouent un rôle ex post facto, une fois qu’une phrase a été énoncée, en vue de reconstruire, comme un détective, ce que le locuteur voulait dire en l’énonçant. Or, la confiance préalable qui nous justifierait à croire autrui se base sur le fait que le locuteur se présente comme une source fiable d’information par le seul fait de nous adresser la parole d’une façon intentionnelle : c’est son acte de nous dire quelque chose qui met en place une relation entre nous basée sur des attentes réciproques.
Un acte de communication est un engagement dans une interaction qui établit non seulement une sérié d’attentes sociales , mais un environnement cognitif partagé. Dans la pragmatique cognitive contemporaine on fait l’hypothèse que chaque acte de communication suscite des attentes de pertinence à partir desquelles les interlocuteurs construisent leurs hypothèses sur ce qui est dit , à l’intérieur d’un environnement cognitif partagé que leurs phrases contribuent à engendrer. A chaque échange conversationnel, notre paysage mental s’enrichit des nouvelles représentations et hypothèses sur le monde que nous construisons « pour le bien de la conversation ». Nous adoptons une posture de confiance dans la volonté de notre interlocuteur d’être pertinent pour nous et de s’engager dans la construction d’un environnement mutuel. Ceci n’implique pas que nous persisterons à croire tout ce que nous aurons accepté pour le bien de la conversation. Une posture de confiance est un ingrédient fondamental du processus de la conversation, mais il s’agit d’une forme de « confiance virtuelle » qui peut être éphémère. Comme dans l’histoire de Mr. Chance, les croyances sur l’économie américaine auxquelles le Président abouti sont engendrées par la posture de confiance qu’il adopte dans son échange avec Mr. Chance. Ces idées cependant sont largement indépendantes de ce que Mr. Chance a dit, et sont issues d’une interprétation fondée sur ce que le Président pensait déjà.
Notre travail cognitif, porté par la confiance que nous faisons à l’intentionnalité de notre interlocuteur, peut largement dépasser, voire s’écarter, de la seule compréhension de ce qui a été dit. La posture de confiance que nous assumons dans une conversation est toute la vulnerabilité cognitive que nous acceptons en nous engageant dans cet échange. Cette confiance est à la fois fondamentale et fragile : elle est nécessaire pour guider nos interprétations, mais elle peut être facilement retirée à la lumière de nouveaux indices. Par le seul fait de s’adresser à nous, autrui nous demande d’adopter une telle posture de confiance. La justification de cette posture n’est pas à chercher dans des propriétés du langage, mais dans la spécificité cognitive et sociale de notre reconnaissance d’un acte intentionnel dont nous sommes le destinataire. Cette posture de confiance peut nous disposer à croire, mais elle n’est pas suffisante à nous rendre crédules : nous élaborons avec notre interlocuteur un environnement cognitif partagé dont les retombées épistémiques relèvent de notre responsabilité. Pour être en situation de croire ce que nous dit autrui, il faut accepter la vulnérabilité que comporte tout engagement dans un échange verbal, mais il n’est pas nécessaire pourtant d’abdiquer notre autonomie cognitive.
Références :
Baldwin, D. Moses, L. (2001) “Links between social understanding and early word learning: Challenges to current accounts” Social Development, 10, p. 309-29.
Bezundehout, A. (1998) « Is Verbal Communication a Purely Preservative Process ? », Philosophical Review, vol. 107, n. 2, p. 261-88.
Bloom, P. (2000) How children learn the meaning of words, Mit Press, Cambridge, MA.
Burge, T. (1993) “Content Preservation”, Philosophical Review, vol. 102, p. 457-88.
Coady, A.C. (1992) Testimony, Clarendon Press, Oxford.
Clément, F. et al (2004) “The ontogenesis of trust” Mind and Language, 19, p. 360-79.
Conein, B. (2005) Les sens sociaux, Economica, Paris.
Koenig, M.A., Harris, P.L. (2005) “The role of social cognition in early trust” Trends in Cognitive Science, vol. 9, n. 10, p. 457-59.
Lackey, L. (2006) “It takes Two to Tango: Beyond Reductionism and Non-Reductionism in the Epistemology of Testimony” in J. Lackey and E. Sosa (eds.) The Epistemology of Testimony, Oxford University Press.
Lackey, L. (à paraître) “Testimony and the Infant/Child Objection”, Philosophical Studies.
Lutz, D., Keil, F. (2002) “Early understanding in the division of cognitive labour”, Child Development, 73, 1073-1084.
Moran, R. (2003) Authority and Estrangement, Harvard University Press, Cambridge, MA.
Moran, R. (2005) “Getting Told and Being Believed” in Philosophers’ Imprint, vol. 5, n. 5, p. 1-29.
Origgi, G. (2004) “Croyance, deference, témoignage” in E. Pacherie, J. Proust (éd.) La philosophie cognitive, Editions Ophrys et Maison de Sciences de l’Homme, p. 167-83.
Origgi, G. (2004) “Is Trust an Epistemological Notion ?” Episteme, vol. 1, n. 1, p. 61-72.
Origgi, G. (2006) « Peut-on être anti-réductionniste à propos du témoignage ? », Philosophie, vol. 88.
Origgi, G. ; Sperber, D. (2000) « On the proper function of language », in P. Carruthers, A. Chamberlain, Evolution and the Human Mind, Cambridge University Press.
Pea, R.D. (1982) « Origings of verbal logic : Spontaneous denials by two and three years old », Journal of Child Language, 9, p. 597-626.
Pouivet, R. (2003) Qu’est-ce que croire? Vrin, Paris .
Rotenberg, K. (1980) “A promise kept, a promise broken: Developmental bases of trust”, Child Development, 51, 2, p. 614-617.
Sabbagh, M.; Baldwin, D. (2001) “Learning words from knowledgeable versus ignorant
Speakers: Link between preschoolers’theory of mind and semantic development”, Child Development, 72, 1054-70.